HELPEN - ASSOCIATION RECONNUE D'INTERET GENERAL - LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL ENTRE PERSONNELS DE L'EDUCATION NATIONALE
Le temps judiciaire face au temps de la souffrance : une mécanique d’épuisement des victimes de harcèlement moral
Lorsqu’un agent de l’Éducation nationale est victime de harcèlement moral, il se retrouve rapidement confronté à un double combat : celui de la souffrance psychologique et physique immédiate, et celui, bien plus long, de la reconnaissance de son préjudice par la justice. Ce décalage, souvent abyssal, entre le temps judiciaire et le temps de la souffrance est l’un des principaux obstacles à la protection des victimes et à la sanction des agresseurs. Il joue en faveur des institutions et des auteurs de harcèlement, qui exploitent cette inertie pour prolonger l’impunité. HELPEN s’attaque particulièrement à la question de l’impunité, car elle intensifie la souffrance et conforte et les harceleurs et une administration fautive de rester inerte. L’inaction est une forme de complicité d’agissements harcelants, au minimum. Le droit pénal doit être adapté à ces nouvelles définitions, et le harcèlement institutionnel doit être reconnu dans l’Education nationale.
Helpen
2/13/20257 min read
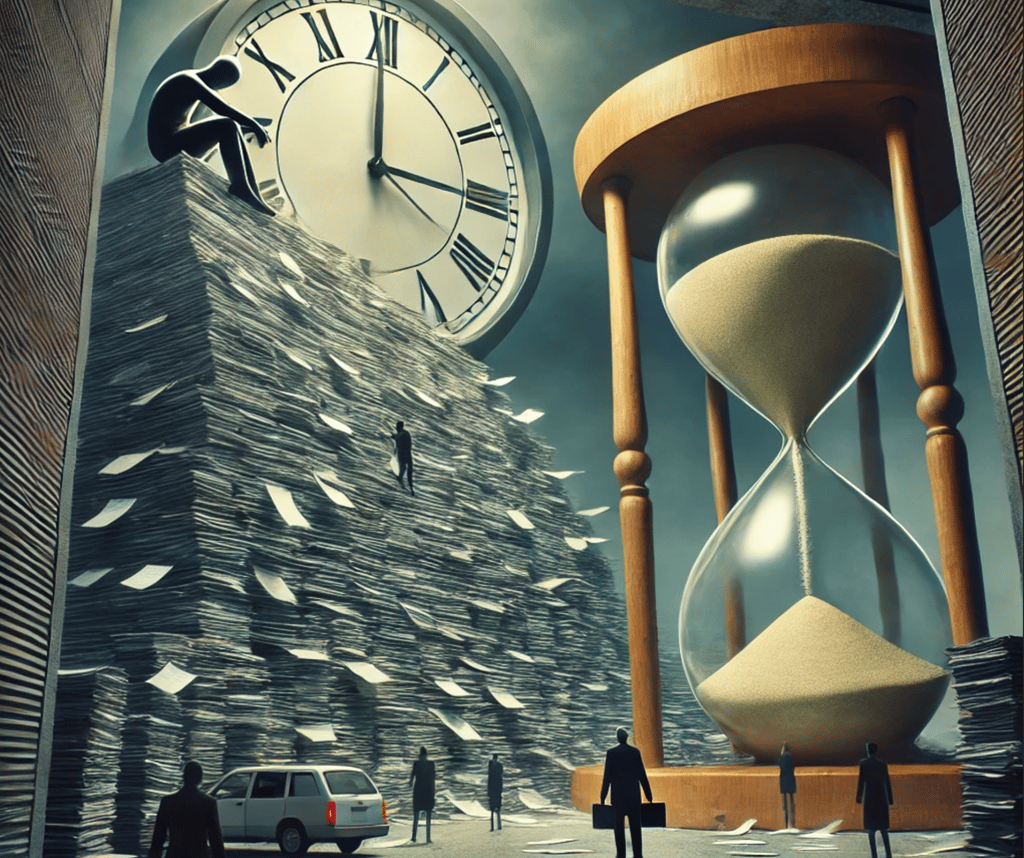

Le temps judiciaire face au temps de la souffrance : une mécanique d’épuisement des victimes de harcèlement moral, bien au delà de l’Education nationale
Lorsqu’un agent de l’Éducation nationale est victime de harcèlement moral, il se retrouve rapidement confronté à un double combat : celui de la souffrance psychologique et physique immédiate, et celui, bien plus long, de la reconnaissance de son préjudice par la justice. Ce décalage, souvent abyssal, entre le temps judiciaire et le temps de la souffrance est l’un des principaux obstacles à la protection des victimes et à la sanction des agresseurs. Il joue en faveur des institutions et des auteurs de harcèlement, qui exploitent cette inertie pour prolonger l’impunité.
HELPEN s’attaque particulièrement à la question de l’impunité, car elle intensifie la souffrance et conforte et les harceleurs et une administration fautive de rester inerte. L’inaction est une forme de complicité d’agissements harcelants, au minimum. Le droit pénal doit être adapté à ces nouvelles définitions, et le harcèlement institutionnel doit être reconnu dans l’Education nationale.
Une souffrance immédiate et quotidienne
Le harcèlement moral se manifeste par des humiliations répétées, du mépris, des mises à l’écart, des brimades subtiles ou explicites. La victime, souvent isolée, voit son état de santé se détériorer rapidement :
- anxiété, stress chronique, attaques de panique,
- troubles du sommeil, fatigue extrême,
- perte de confiance en soi, isolement social,
- dépression, idées suicidaires.
Ces effets sont immédiats. En quelques semaines, une personne harcelée peut être irrémédiablement fragilisée, voire en incapacité de travailler. Pourtant, pendant que son mal-être grandit, la justice avance à un rythme infiniment plus lent.
Exemple 1 : Une enseignante marginalisée et poussée au départ
Madame L., professeure en lycée, a commencé à subir des pressions après avoir dénoncé des dysfonctionnements dans son établissement. Sa direction l’a progressivement mise à l’écart, l’empêchant d’accéder aux ressources pédagogiques et réduisant ses heures de cours. Les réunions auxquelles elle devait assister ont été organisées sans qu’elle en soit informée, et elle a été exclue des projets collectifs.
En quelques mois, son état psychologique s’est dégradé : insomnies, angoisses, perte de confiance en elle. Elle a déposé un signalement auprès du rectorat, mais aucune enquête n’a été ouverte. Elle a alors saisi le tribunal administratif, mais l’audience a été fixée trois ans plus tard. Entre-temps, ne supportant plus l’isolement et les humiliations, elle a démissionné. Son dossier, encore en cours, n’aura finalement aucun impact sur ceux qui l’ont poussée au départ.
Un parcours judiciaire long et complexe
La reconnaissance du harcèlement moral repose sur une accumulation de preuves et une succession d’étapes procédurales qui s’étirent sur plusieurs années.
1. Dépôt de plainte ou de recours administratif
- Le premier obstacle est la reconnaissance des faits. Dans l’Éducation nationale, l’administration adopte souvent une posture de déni ou de minimisation des signalements.
- La hiérarchie, lorsqu’elle est impliquée dans le harcèlement, exerce parfois des pressions sur la victime ou sur les témoins pour faire taire l’affaire.
- Il faut fournir des preuves solides (témoignages, mails, certificats médicaux…), ce qui est difficile lorsque le harcèlement repose sur des comportements insidieux et répétitifs.
2. Enquête et instruction
- Si la plainte est acceptée, une enquête commence, mais elle peut prendre des mois voire des années, comme dans le cas de ce collègue dont la plainte date de 2021, sans la moindre action de la police ou de la justice, et qui est toujours soumis aux agissements d’au moins un de ses harceleurs.
- L’administration traîne volontairement des pieds pour remettre les documents nécessaires, rendant l’instruction encore plus longue. Même condamnée par le tribunal administratif, elle ne transmet pas les documents pourtant nécessaires à la compréhension d'une situation (dossier administratif, preuves etc.) et refuse obstinément de protéger la victime, même en cas d'obtention de la protection fonctionnelle.
3. Audience et décision
- Une fois l’affaire jugée, il faut encore attendre une décision.
- Dans la fonction publique, les condamnations sont rares, et les sanctions restent souvent symboliques.
- Pendant tout ce temps, l’agresseur peut continuer d’occuper son poste, tandis que la victime est souvent en arrêt maladie ou contrainte à une mutation forcée. Si le harceleur est finalement reconnu coupable et condamné, il sera discrètement déplacé dans un poste à responsabilités et rarement sanctionné.
Un facteur clé de cette lenteur judiciaire réside dans le manque criant de moyens alloués à la justice, en particulier dans le domaine pénal. Avec des tribunaux engorgés, des effectifs insuffisants et des ressources limitées, les délais d’instruction s’allongent inexorablement. Ce sous-financement chronique ne fait qu’aggraver la détresse des victimes, enfermées dans une attente interminable où l’espoir d’une résolution s’érode jour après jour.
Exemple 2 : Un enseignant accusé à tort et broyé par la machine administrative
Monsieur B., enseignant expérimenté en lycée, a subi une campagne de rumeurs orchestrées par certains de ses collègues, relayées auprès de la direction. De fausses accusations de comportements inappropriés ont été portées contre lui.
Plutôt que d’enquêter sur la véracité des faits, le rectorat l’a immédiatement écarté de son poste, sans lui fournir d’explication officielle. Il a dû attendre six mois pour obtenir un rendez-vous avec les ressources humaines, et deux ans avant que la justice ne reconnaisse que les accusations étaient infondées.
Pendant cette attente, il a perdu son poste, sa réputation et a vu sa santé mentale se détériorer. Malgré son acquittement, il n’a jamais été réintégré à son ancien poste et a été forcé de muter dans un autre établissement, à des centaines de kilomètres de chez lui.
Une stratégie de l’usure institutionnelle
Ce décalage entre le temps de la souffrance et le temps judiciaire n’est pas qu’une conséquence malheureuse du fonctionnement de la justice : il est une arme institutionnelle utilisée pour épuiser les victimes.
• Silence et inertie administrative : en ne répondant pas aux alertes, en multipliant les procédures et en niant la souffrance, l’institution décourage les victimes.
• Absence de protection immédiate : même lorsqu’un harcèlement est avéré, la victime doit souvent continuer à travailler sous l’autorité de son agresseur, ajoutant une souffrance supplémentaire.
• Isolement des victimes : la longueur des procédures entraîne souvent une rupture avec les collègues, une perte de repères professionnels et une fatigue mentale extrême.
• Pertes financières et instabilité : les arrêts maladie prolongés, les mutations forcées ou les reconversions subies accentuent la précarité des victimes, qui finissent par renoncer ou quitter leur métier.
Exemple 3 : Un cas qui nous tient à coeur
Un enseignant, reconnu pour son engagement pédagogique et son travail auprès des élèves, a subi une campagne de harcèlement initiée par des collègues et couverte par sa hiérarchie, qui a fini par se joindre au harcèlement. De fausses accusations ont été montées contre lui, entraînant des enquêtes biaisées et une absence totale de soutien institutionnel.
Malgré de multiples alertes et demandes de protection fonctionnelle, l’administration a gardé le silence, retardant chaque réponse et laissant la situation empirer. Ce mutisme a duré plusieurs années, plongeant l’enseignant dans une lutte épuisante contre un système qui l’isolait de plus en plus.
Le combat judiciaire, toujours en cours, révèle une stratégie évidente : gagner du temps, décourager, et espérer que la victime abandonne. Cette tactique permet d’éviter toute remise en question du système, au prix d’un immense coût humain.
L’exemple de l’académie de Normandie : quand l’omerta tue
L’affaire des suicides dans l’académie de Normandie depuis 2024 en est une illustration dramatique. Malgré l'alerte lancée par la sénatrice Madame Morin-Desailly il y a un mois, aucune communication n'a été faite par l'administration. Nos trois courriers à la rectrice de cette académie sont restés sans réponse. Un responsable ISST a proposé d'entrer en contact avec nous à ce sujet, puis depuis - sans surprise - silence radio. Voilà comment une dizaine de cas de suicides de membres de l'Education sont considérés par les hautes instances de l'Education nationale, ISST, DGRH, recteur.
Seule Madame la Sénatrice nous a répondu, et nous irons à sa rencontre très prochainement pour échanger sur les solutions concrètes à mettre en place.
Depuis juin 2024, plusieurs enseignants se sont suicidés, dans un contexte de pressions professionnelles insoutenables. Ces drames ont été dissimulés pendant des mois par l’administration, qui a ignoré les demandes de réunion d’une formation spécialisée exceptionnelle pour en discuter. Nous avons reçu plusieurs témoignages qui mentionnent des fiches RSST "oubliées" ou des signalement formels méprisés, jusqu'à des menaces couvertes par des membres de l'administration de cette académie.
Ici, la mécanique du silence et de la lenteur administrative a joué un rôle central :
- Les alertes des victimes et de leurs représentants ont été ignorées.
- Les familles et collègues des victimes n’ont reçu aucune explication officielle.
- L’administration a gagné du temps pour éviter un scandale public.
Cet exemple tragique illustre parfaitement comment le temps judiciaire et administratif sert à enterrer les affaires, tandis que le temps de la souffrance, lui, n’attend pas.
Que faire pour briser cette mécanique infernale ?
Pour réduire cet écart insupportable entre souffrance et reconnaissance judiciaire, plusieurs actions doivent être engagées :
1. Mise en place d’un signalement rapide et efficace
- Obligation de répondre aux alertes sous 15 jours.
- Automatisation des signalements par la dématérialisation des RSST
- Mise en place de cellules indépendantes de traitement des plaintes.
2. Protection immédiate des victimes
- Suspension préventive des agresseurs présumés, comme dans les affaires de violences sexuelles.
- Facilitation des mutations pour les victimes qui le demandent.
3. Accélération des procédures judiciaires
- Création de juridictions spécialisées pour le harcèlement moral dans la fonction publique.
- Sanctions immédiates en cas de non-réponse de l’administration aux alertes.
4. Visibiliser les affaires pour briser l’omerta
- Communication publique et transparente sur les cas signalés, interventions dans les médias.
- Soutien actif aux victimes par les associations comme la nôtre, au delà des déclarations d'intention.
Tant que le temps judiciaire restera aussi lent face à l’urgence de la souffrance, l’Éducation nationale continuera de broyer ses agents sans conséquences pour les harceleurs. Il est urgent de sortir de cette spirale infernale et inacceptable où la victime est abandonnée, où l’institution joue la montre, et où les drames humains se répètent dans une indifférence organisée. Que la honte change de camp.
HELPEN continuera de dénoncer ce décalage et d’exiger des réformes profondes pour que les victimes soient enfin entendues, protégées et reconnues.
Solidarité, combativité
Luttons ensemble contre le harcèlement moral dans l'Education nationale. Tout don à Helpen offre 66% de réduction d'impôts.
© 2024-2026. All rights reserved (INPI). HELPEN - 22 rue de la Saïda - 75015 PARIS
contact@helpen.fr (en pause du 20 février au 9 mars 2026) - CETTE ADRESSE MAIL NE RECOIT NI TEMOIGNAGES NI PIECES JOINTES.
IMPORTANT - Les dépôts de témoignage se font sur la plateforme helpen.eu, pas par courriel. Les témoignages sont déposés sur le site intranet réservé aux adhérents, pour des raisons de sécurité / confidentialité.


